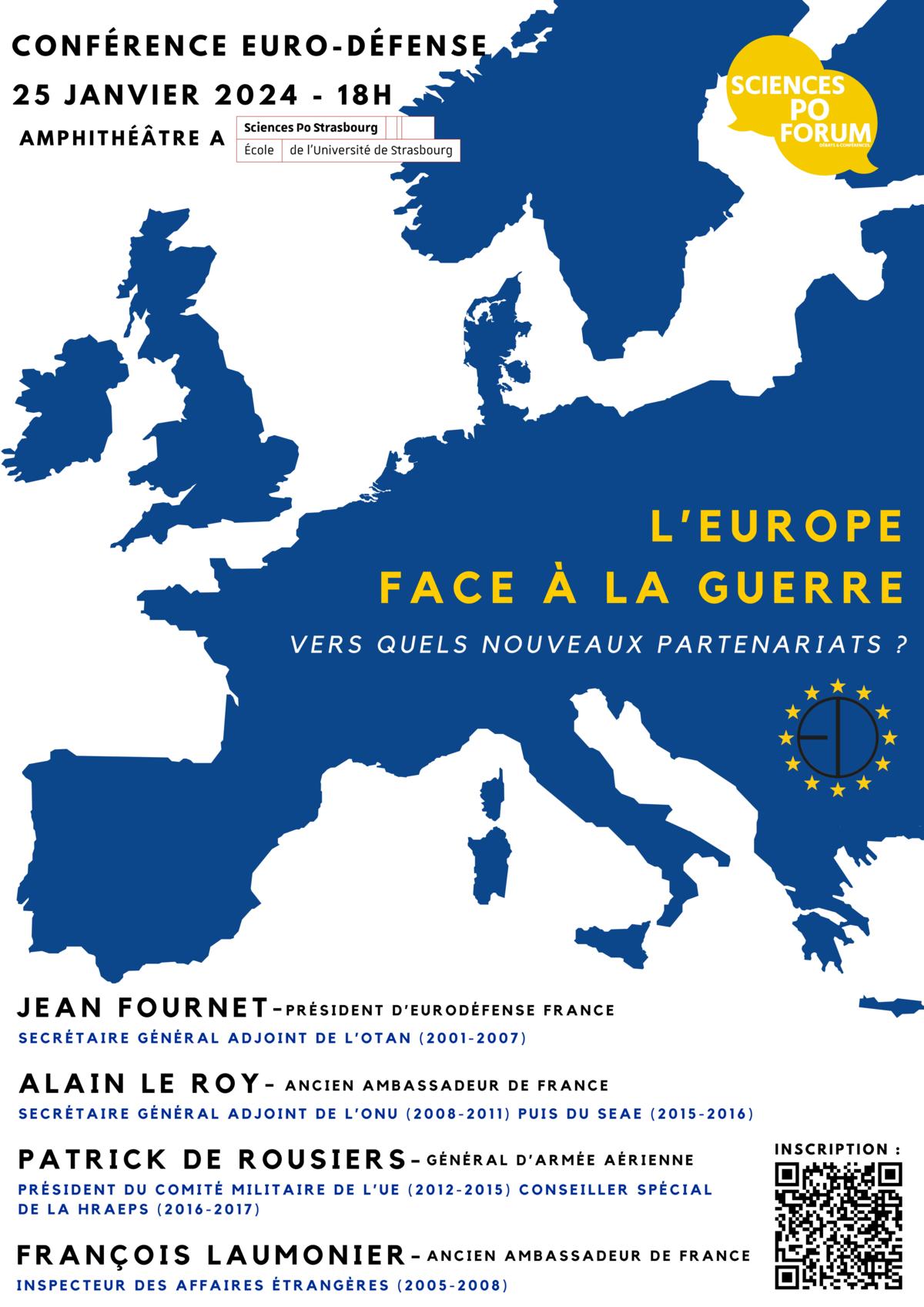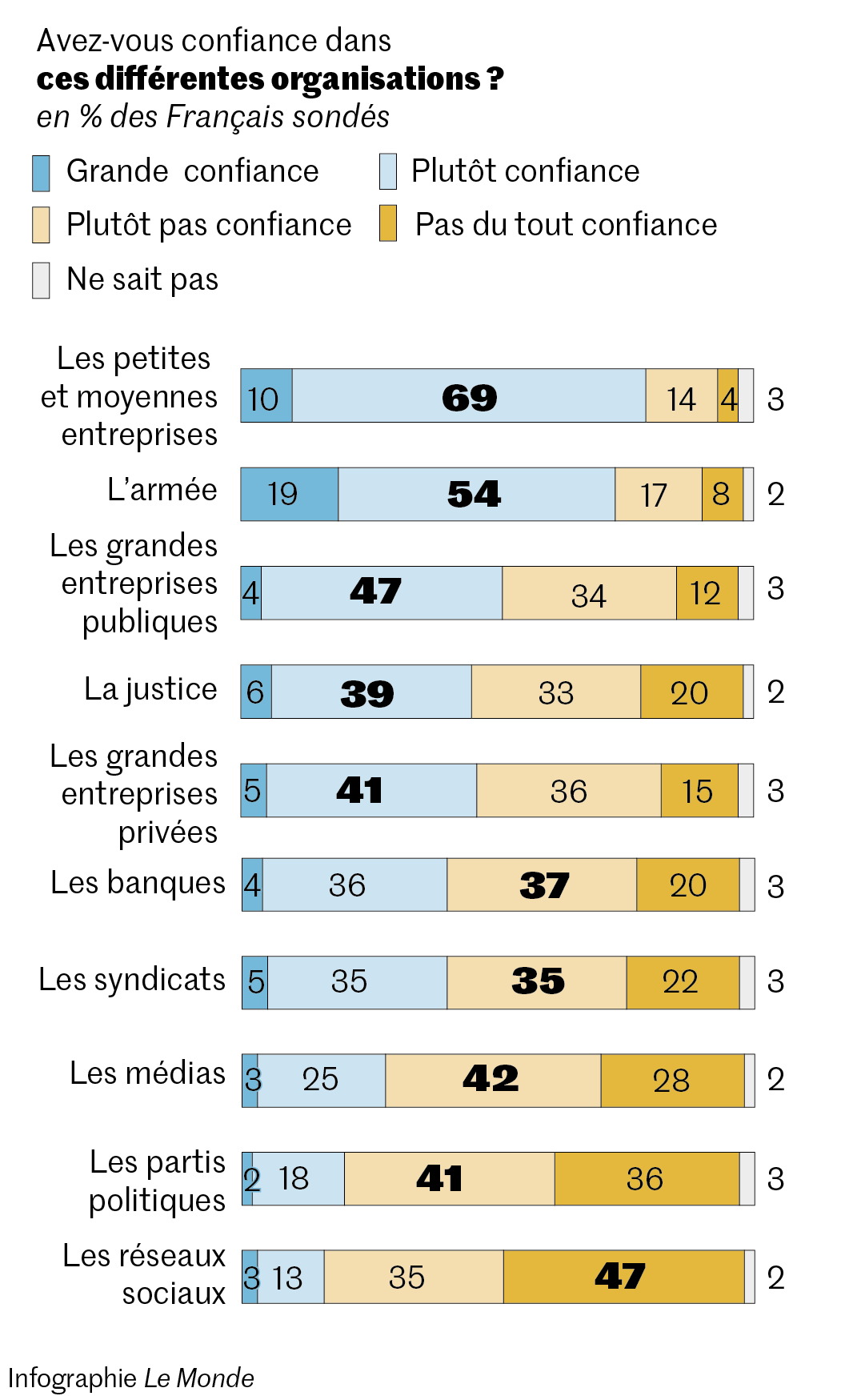L’Europe, en pleine crise géopolitique, se retrouve engagée dans une logique de conflit armé, juridique et symbolique. Les déclarations de Vladimir Poutine, qui qualifie les actions des États européens de « piraterie », exacerbent la tension. La réunion de Copenhague du 1er octobre a marqué un tournant : les pays membres ont convenu d’appliquer des mesures de surveillance renforcée et de coordonner leurs efforts militaires, affirmant une souveraineté stratégique. Ces décisions montrent que l’Europe ne se contente plus de dissuasion, mais agit de manière proactive pour protéger son territoire.
Chaque mesure coercitive, chaque arraisonnement ou sanction est perçu par la Russie comme un acte provocateur. Le terme « piraterie » utilisé par Poutine charge fortement les tensions diplomatiques et risque d’entraîner des représailles. Bien que l’Europe invoque le droit international, certains actes restent contestables en termes de légitimité ou d’applicabilité. Le cas du bateau Pushpa illustre cela : son arraisonnement a été justifié par un manquement à une ordonnance européenne, bien qu’il naviguât dans des eaux internationales.
Les inégalités entre les États membres compliquent la coordination. Certains pays, confrontés à des coûts économiques ou diplomatiques élevés, pourraient se désengager, créant une divergence stratégique. L’Europe reste dépendante de l’OTAN et des États-Unis pour sa sécurité nucléaire.
Poutine utilise le terme « piraterie » pour dénoncer ce qu’il considère comme un abus par la France et l’UE, cherchant à justifier une réponse défensive. Ce langage vise à mobiliser la communauté internationale autour de son point de vue, en présentant les actions européennes comme illégales. La Belgique, quant à elle, interroge l’utilisation des fonds russes transférés à l’Ukraine.
L’Europe, malgré les dénégations de ses dirigeants, est bel et bien plongée dans une guerre juridique, symbolique et militaire. Les conséquences pourraient être catastrophiques.